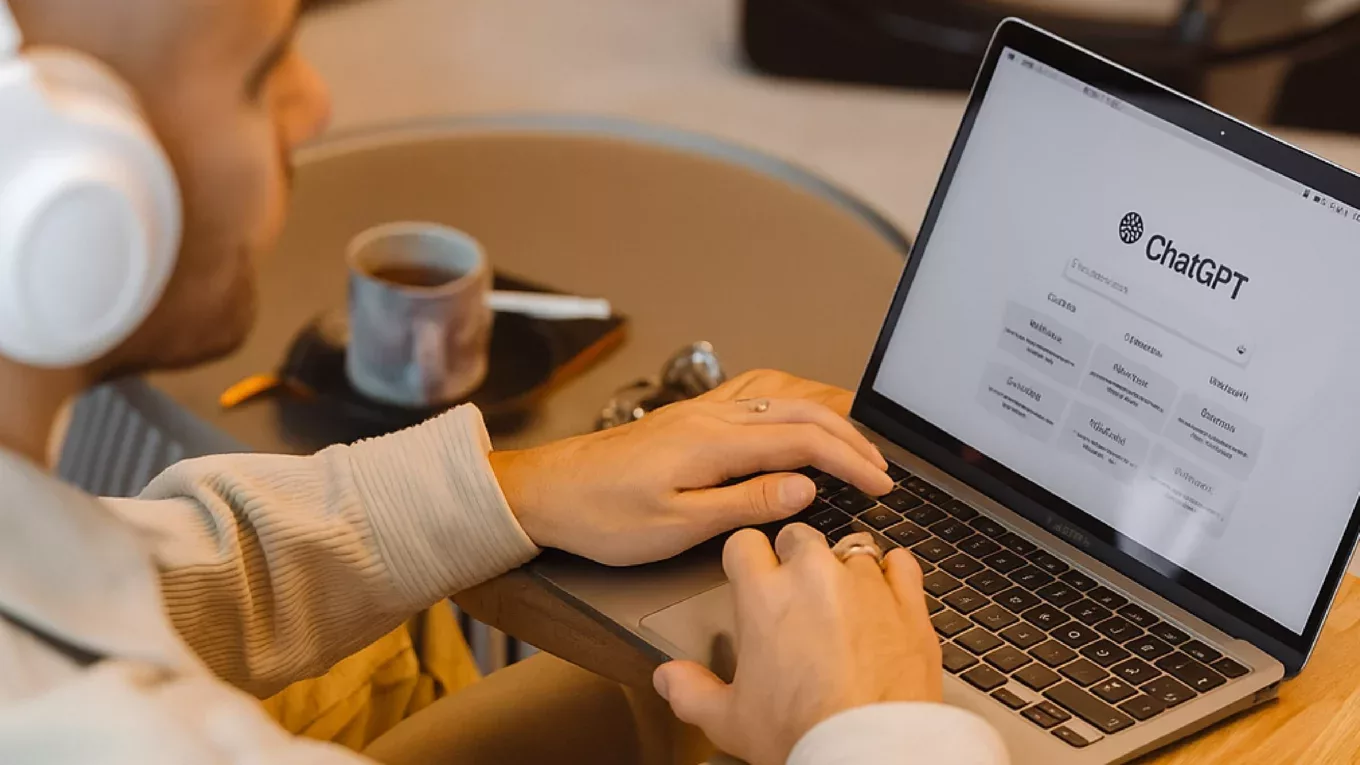On l’entend partout : l’intelligence artificielle s’apprêterait à détruire des millions d’emplois. Certaines études alimentent le scénario d’une grande substitution des humains par les machines. Mais derrière ces projections spectaculaires se dessine une autre réalité : l’IA ne fait pas que remplacer, elle transforme les métiers, en crée de nouveaux et revalorise des compétences bien humaines. Si elle est accompagnée, elle peut devenir moins une menace qu’un puissant moteur d’innovation, d’emploi et de progrès social.
Discours dystopiques, projections alarmistes ou suppressions de postes : le narratif dominant autour de l’intelligence artificielle (IA) dans le monde du travail reste largement anxiogène. Selon EY (source WEF) (2023), sur 673 millions d’emplois analysés à l’échelle mondiale, 83 millions pourraient disparaître d’ici 2027 tandis que 69 millions seraient créés en parallèle. Un rapport de Goldman Sachs plus récent anticipe, pour sa part, que 45 % des emplois administratifs de la zone euro sont menacés par l’automatisation, tout comme 30 % des postes d’encadrement intermédiaire. Quant à McKinsey, il estime que jusqu’à 30 % des tâches actuelles pourraient être automatisées d’ici 2030. « On est en termes d’impact sur une technologie qui va avoir un impact plus conséquent que l’arrivée cumulée de l’ordinateur, d’Internet et du smartphone », pose d’emblée Cyril de Sousa Cardoso, président du groupe Polaria, auteur et expert en IA. De quoi alimenter l’idée d’une « fin du travail » prophétisée par l’économiste Daniel Susskind dans A World Without Work (2020).
Pourtant, une lecture plus nuancée s’impose. Car l’IA, loin de se limiter à remplacer l’humain, redessine les contours des métiers, stimule la créativité et ouvre la voie à des fonctions inédites. D’après une étude récente de Morgan Stanley, 90 % des professions seront touchées par l’IA… mais souvent de manière enrichissante, en alliant intelligence humaine et exécution automatisée. En clair, l’impact net pourrait être positif sur la croissance de l’emploi et sur la valeur ajoutée des tâches confiées aux humains. La question de l’IA n’est plus seulement technologique : elle est sociale et politique. C’est un choix de société, celui d’investir dans les compétences, la requalification et la complémentarité homme-machine pour faire de l’IA un levier de progrès. Décryptage d’une révolution sociétale en marche.
IA : de nouveaux métiers en émergence

Avec l’essor fulgurant des intelligences artificielles génératives et des agents IA, les entreprises ne se contentent plus d’intégrer de nouveaux outils : elles inventent aussi de nouveaux métiers spécialisés. L’étude KPMG (AI Quarterly Pulse, 2025) recense plusieurs rôles, à la frontière du technique, de l’éthique et du stratégique. On y retrouve par exemple le Prompt Engineer, chargé de concevoir et affiner les requêtes pour obtenir des réponses pertinentes ; l’AI Ethics Officer, garant d’un usage responsable et conforme aux règles ; ou encore le Data Curator, qui nettoie et structure les données alimentant les modèles. À ces profils s’ajoutent l’AI Product Manager, véritable trait d’union entre la technologie et les besoins business, et le Governance Specialist, chargé de mettre en place les politiques internes de supervision. Thierry Taboy, référent fédéral IA à la CFE-CGC, invite toutefois à relativiser cet enthousiasme : « À court terme, on voit émerger beaucoup de métiers très techniques. Mais à la vitesse où tout évolue, le véritable enjeu n’est peut-être pas là… Il est dans les nouveaux rapports humains que ces technologies ultra-performantes créent. Impossible aujourd’hui de dire si ces fonctions dureront. »
IA : vers une recomposition des métiers existants

Phénomène beaucoup plus structurant : la reconfiguration profonde des fonctions. Selon Thierry Taboy : « nous assistons surtout à une modification des contours des métiers : certains postes vont disparaître, mais majoritairement, ils vont se réinventer. » En d’autres termes, l’IA ne supprime pas massivement les emplois : elle transforme la manière même de travailler. Cyril de Sousa Cardoso partage ce constat et insiste sur le caractère inédit de cette recomposition : « L’IA vient disrupter le travail là où on ne l’attendait pas, c’est-à-dire sur les tâches cognitives et même à forte valeur ajoutée. »
Cette mutation s’inscrit dans le cadre théorique de référence : Routine-Biased Technical Change (RBTC). Formalisée dans les années 2000 par les économistes David Autor, Frank Levy et Richard Murnane, le modèle explique que le progrès technologique ne remplace pas les travailleurs selon leur niveau de qualification, mais selon la nature des tâches qu’ils accomplissent. Contrairement à la vision classique où la technologie détruit les emplois peu qualifiés pour en créer de plus qualifiés, le RBTC montre que les outils numériques automatisent avant tout les tâches routinières, qu’elles soient manuelles (dans l’industrie ou la logistique) ou intellectuelles (dans la comptabilité, l’administration ou la programmation). En revanche, les tâches non-routinières, mobilisant créativité, sens critique, jugement ou relationnel, résistent mieux à l’automatisation et tendent même à gagner en valeur.
Les données récentes confirment cette évolution. Selon le GenAI Skill Transformation Index, sur 2 900 compétences analysées, seules 19 apparaissent comme hautement « substituables ». Les développeurs, analystes et comptables – dont plus de 70 % des compétences sont jugées « transformables » – sont en première ligne. Le marketing suit, avec près de 69 % de ses tâches désormais effectuées en mode « hybride », où l’IA exécute et l’humain supervise. Dans l’informatique, le phénomène est particulièrement net : l’IA génère le code répétitif, laissant aux développeurs le soin de corriger, d’orienter et de créer davantage de valeur.
Compétences : la revanche des soft skills et des savoirs fondamentaux

Mais avec l’IA générative, le modèle RBTC atteint ses limites. En automatisant désormais des tâches cognitives et créatives, elle le met littéralement « sous stéroïdes », selon Laura D. Tyson et John Zysman (Dædalus, 2022). L’automatisation ne se contente plus de cibler les tâches routinières : elle rebat les cartes du travail et redéfinit la part proprement humaine des métiers.
C’est ainsi qu’intervient un véritable déplacement de la valeur, observe Cyril de Sousa Cardoso : « Une partie des tâches cognitives est captée par l’IA ; les compétences bougent. » Savoir utiliser l’intelligence artificielle devient indispensable, mais la maîtrise technique ne suffit pas. Pour bien prompter, il faut savoir bien écrire ; pour collaborer avec l’IA, il faut mobiliser culture générale, sens critique, logique et recul éthique. Les fondamentaux — culture générale, mathématiques, capacité à débattre, pensée philosophique — reprennent toute leur importance.
La valeur humaine se concentre désormais sur ce qui échappe aux machines : l’interaction, le jugement, la perception sensible du monde. Comme le résume le paradoxe de Moravec, les ordinateurs excellent dans les calculs complexes mais peinent à percevoir, ressentir ou coopérer. « La pertinence opère lorsque l’humain est capable de restituer ses perceptions sensorielles (fruit de l’évolution du corps et des neurones) à l’IA », insiste Cyril de Sousa Cardoso.
Cette transformation impose un upskilling massif, selon Thierry Taboy. Néanmoins, il ne s’agit pas seulement de former aux outils, mais d’inscrire les salariés dans un apprentissage continu, au rythme de l’évolution des métiers. « Le renforcement des compétences critiques et expertes devient essentiel pour garder la main sur la qualité et le sens du travail produit », souligne-t-il. Trois capacités sortent du lot : la vérification des productions générées par l’IA, l’exercice du discernement et la collaboration interdisciplinaire.
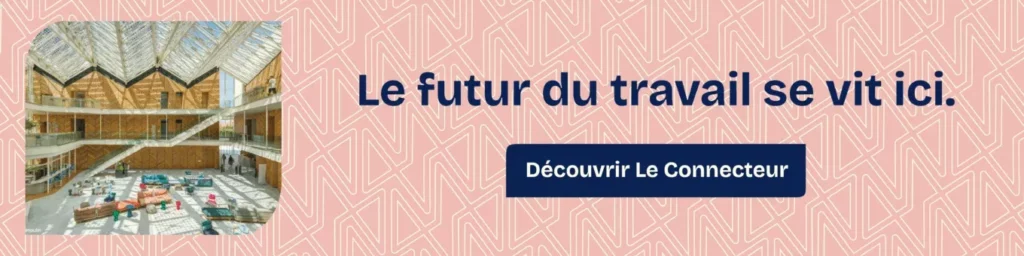
IA et travail : un nouveau pacte à inventer
L’hybridation réussie entre l’humain et l’IA ne dépend pas seulement des technologies mises en place, mais de l’environnement de travail et de la culture collective. Comme le rappelle Thierry Taboy, « c’est un projet de transformation de l’organisation dans son ensemble, qui doit viser une IA qui enrichit le travail et les individus, et non un productivisme “taylorisé” qui aliène ».
Trois conditions sont nécessaires pour parvenir à une « IA encapacitante » :
- La première est stratégique : si l’adoption de l’IA est imposée d’en haut, elle génère peur et rejet. Elle doit être portée par l’envie des salariés eux-mêmes, en lien avec leur expertise métier.
- La deuxième est culturelle : « pas de formations génériques ou superficielles, mais des apprentissages ciblés, ancrés dans les pratiques réelles, avec des bibliothèques de prompts co-construites par les équipes », souligne Thierry Taboy.
- Enfin, la troisième est collective : l’IA doit renforcer la coopération plutôt que l’isolement, en s’appuyant sur des réseaux simples et agiles où chacun partage ses découvertes et bonnes pratiques.
Reste une question décisive : celle du temps libéré. « S’il est invisibilisé, il devient délétère ; mais s’il est réinvesti dans la lecture, la pluridisciplinarité ou la rencontre humaine, il devient un levier d’enrichissement et de sens », souligne Thierry Taboy. Ce constat rejoint le paradoxe de l’accélération décrit par le sociologue Hartmut Rosa : chaque technologie censée libérer du temps finit par accélérer nos vies. Avec l’IA, l’enjeu est précisément d’échapper à ce piège en inversant la perspective, selon Cyril de Sousa Cardoso : « au lieu de faire mieux et plus vite ce qu’on faisait déjà, osons imaginer de nouveaux produits, de nouveaux services et des usages inédits. »
IA, d’abord un miroir de notre projet sociétal ?
L’IA n’est pas une menace, mais un révélateur : elle nous oblige à choisir le type de société que nous voulons bâtir. Si nous en faisons un projet collectif plutôt qu’un simple levier productiviste, elle peut devenir non pas la prophétie d’une disparition, mais la promesse d’une renaissance du travail.