La culture d’entreprise est devenue l’un des premiers leviers pour attirer, engager et retenir les talents. Valeurs, rituels, comportements : elle promet du sens, un collectif et des repères face à l’incertitude. Pourtant, à force d’être sacralisée, elle peut aussi glisser vers la norme, voire la contrainte. Comment préserver son rôle pivot… sans en faire un credo professionnel ?
Derrière les open spaces et les slogans affichés, la culture d’entreprise reste avant tout un liant et un sens partagé. De nombreux témoignages soulignent l’importance de cette boussole culturelle au travail. Pour Cyrille Gelgon, responsable administratif et financier chez TRUSK, elle repose sur un socle collectif : « Notre culture est essentielle, car elle s’appuie sur la solidarité, le respect et l’esprit d’équipe. »
Même conviction pour Capucine Roche, PDG de Letsignit : « Ce n’est pas un mot à la mode ni un joli poster au mur. Il s’agit d’un guide pour prendre nos décisions et nous relier les uns aux autres. » Une vision que partage Nelly Grellier, directrice marketing et communication chez OCTO Technology : « Tout système doit reposer sur une colonne vertébrale. Pour l’entreprise, c’est la culture, à condition qu’elle soit incarnée. » Enfin, Bénédicte Tilloy, ancienne DRH de SNCF Réseau, résume : « C’est ce qu’on fait sans savoir que ça nous définit. »
Ces regards convergent : la culture d’entreprise est à la fois socle, boussole et miroir collectif. Mais à force d’être invoquée à l’envi, elle prend des allures de culte. Alors, comment entretenir ce besoin de croire, voire de transcendance, sans tomber dans le dogmatisme ?
Culture d’entreprise : une sémantique chargée d’histoire
Dans le monde du travail, la culture désigne l’ensemble des repères qui soudent le collectif, à savoir les valeurs, les comportements, les symboles ou encore les rituels. Elle agit comme une matrice invisible : ce qui relie les individus à un objectif. Pour David Bernard, fondateur d’AssessFirst, « cela renvoie directement à la question de l’identité : qui on est en tant que collectif. » Une vision partagée par Maurice Thévenet (CNAM, ESSEC) dans son livre La culture d’entreprise (Collection Que sais-je ?), qui la définit comme « un ensemble de références partagées dans l’entreprise, consciemment ou pas, forgées au fil de son histoire ».
Mais avant d’être organisationnelle, la culture est un mot hérité de notre histoire philosophique. « Au XVIIIᵉ siècle, elle désigne l’ensemble des savoirs et des usages qui cultivent l’homme », rappelle Delphine Jouenne, linguiste et autrice de Les (bons) mots du travail. « Au XIXᵉ, elle devient collective : ce n’est plus ce que chacun cultive en soi, mais ce qu’une société cultive en commun. » Entre Kant et Nietzsche, la culture oscille déjà entre élévation et contrainte : elle émancipe autant qu’elle formate. Ce paradoxe irrigue aujourd’hui l’entreprise moderne : la culture est perçue et vécue à la fois espace d’inspiration collective et cadre normatif des comportements.
De la culture au culte : vers le glissement spirituel du travail
Du repère au contrôle : le tournant normatif
Chaque entreprise a ses codes, son langage, ses rituels. Chez Google, on parle des Googlers comme d’une communauté. Les all hands, afterworks ou réunions d’équipe deviennent autant de rites de cohésion, où le collectif vit et se reconnaît. Chez AssessFirst, cette culture est pleinement assumée : « L’entreprise valorise les profils qui osent, expriment leurs idées et font bouger les lignes. »
Les rituels, explique David Bernard, ne servent pas à entretenir une façade, mais à vérifier, au fil du temps, si les valeurs se traduisent dans le réel, à travers des moments collectifs, des célébrations ou des feedbacks ouverts. Certaines entreprises vont plus loin, en gravant leur identité dans des culture books. Netflix a popularisé ce format : un manifeste de plusieurs dizaines de pages détaillant valeurs, comportements et vocabulaire maison. Pour Delphine Jouenne, ces ouvrages s’apparentent à de véritables « catéchismes modernes », tant ils codifient la manière d’être, de parler et de penser au sein de l’entreprise.
La quête de sens : prétexte ou vrai projet collectif ?
Le vocabulaire managérial s’est, lui aussi, peu à peu « spiritualisé ». Les organisations parlent désormais de raison d’être, de mission, de communauté, parfois même de vocation. « L’entreprise s’est approprié le registre du religieux, observe Delphine Jouenne : la direction se mue en clergé symbolique, le manager devient mentor, et les réunions prennent des allures de rituels. »
Ce glissement répond à un besoin plus large : « Les salariés aspirent à rejoindre des entreprises qui participent à une mission à la fois sociale, écologique et humaine. C’est une manière de retrouver du sens », poursuit-elle.
Culture affichée vs culture vécue : attention à l’effet Potemkine
Mais cette ferveur culturelle n’est pas sans dérives. « Beaucoup d’entreprises affichent une culture incroyable, mais vivent tout autre chose à l’intérieur », prévient David Bernard. Ce décalage crée une dissonance que les collaborateurs perçoivent immédiatement. Pour lui, la culture ne doit pas être un discours, mais un ancrage comportemental : « C’est le gouverneur intérieur de l’entreprise, ce qui guide les décisions quand le leader n’est pas dans la pièce. »
Reste à trouver l’équilibre : comment préserver un élan collectif engageant… sans verser dans l’homélie professionnelle ?
Du culte au réel : 5 pistes pour incarner sa culture d’entreprise
Comme le résume David Bernard, « la culture d’entreprise, c’est qui tu recrutes, qui tu promeus et qui tu décides de faire partir ». Autrement dit, elle ne se décrète pas : elle se vit au quotidien. Propositions croisées pour une culture robuste et incarnée :
1. La faire vivre au quotidien
« Une culture ne se possède pas, elle se vit, elle se transforme », rappelle Delphine Jouenne. David Bernard renchérit : « Il y a toujours deux cultures : celle qu’on affiche — souvent aspirationnelle — et celle qu’on vit vraiment. »
Elle n’a de sens que si elle se traduit dans les comportements, les décisions et les rituels. « Le pire risque, c’est la culture tiède, celle qui veut plaire à tout le monde. Une culture forte est forcément un peu clivante, mais elle donne une direction », insiste-t-il.
→ Bonne pratique : intégrer un indicateur culturel dans les entretiens managériaux. Au lieu de mesurer uniquement la performance, évaluer également la cohérence entre décisions, comportements et culture.
2. S’ouvrir à la critique et au doute
Une culture vivante doit être perméable à la contradiction. Delphine Jouenne rappelle qu’il faut « mettre en place le droit au doute, à la critique, et créer des espaces de parole où chacun puisse s’exprimer sincèrement, sans crainte ». David Bernard complète : « Tu ne peux pas décréter une culture. Si tu veux la faire évoluer, tu dois le faire avec les collaborateurs. »
C’est donc dans le dialogue — et non dans la proclamation — que la culture se construit. Ces espaces d’expression deviennent des garde-fous contre la dérive religieuse ou dogmatique.
→ Bonne pratique : organiser régulièrement des forums culture ou cercles de feedback où les équipes discutent librement de la cohérence entre valeurs affichées et vécu quotidien, avec un engagement clair de la direction à en tirer des décisions concrètes.
3. Cultiver la diversité
Delphine Jouenne met en garde contre une culture d’entreprise qui, « là où elle pourrait créer de la cohésion, finit parfois par valoriser l’uniformité ». Pour David Bernard, la clé est d’avoir des repères communs… mais des voix multiples : « Un collectif ne peut pas fonctionner si tout le monde regarde dans des directions opposées. Mais il faut un certain degré de diversité, sinon la culture devient stérile. »
Recruter des profils variés, aux parcours et sensibilités différentes, c’est accepter que le collectif évolue avec son environnement, plutôt que de chercher à l’enfermer.
→ Bonne pratique : inclure systématiquement un « challengeur culturel » dans les recrutements, une personne extérieure à l’équipe qui évalue non pas la conformité au « fit culturel », mais la capacité du candidat à enrichir la culture existante (culture add).
4. Valoriser l’erreur comme levier de confiance
« Quand la direction est capable de dire je me suis trompé, cela crée de la légitimité et du lien », note Delphine Jouenne. Autrement dit, dans une culture fondée sur la croyance, l’erreur est une faute. Dans une culture authentique, elle devient une ressource.
David Bernard insiste, lui, sur la cohérence : « Si tu veux un socle robuste, tu dois agir en conséquence, même quand les décisions sont difficiles. Par exemple, te séparer d’un “top performer” dont les comportements sont contraires aux valeurs. » La sincérité managériale, y compris dans la reconnaissance des erreurs, fonde la crédibilité du collectif.
→ Bonne pratique : instaurer un rituel post-mortem ou Fail Friday, où les équipes partagent collectivement leurs erreurs de la semaine, ce qu’elles en ont appris et comment elles adapteront leurs pratiques.
5. Éviter le culture washing
Une culture inspirante repose sur la cohérence entre discours et pratiques. « Tu ne peux pas prêcher l’inclusivité si tu nommes ton pote à un poste de manager. Chaque décision envoie un message culturel », rappelle David Bernard. Delphine Jouenne en tire le même enseignement : « Une culture vivante se niche dans les détails, dans les interactions. »
La crédibilité culturelle se construit ainsi dans l’ordinaire du travail, bien plus que dans les grands discours.
→ Bonne pratique : auditer régulièrement les signaux culturels de l’entreprise (promotions, primes, nominations, feedbacks, communication interne) pour vérifier leur cohérence avec les valeurs affichées. Ce contrôle peut être confié à un comité transversal.
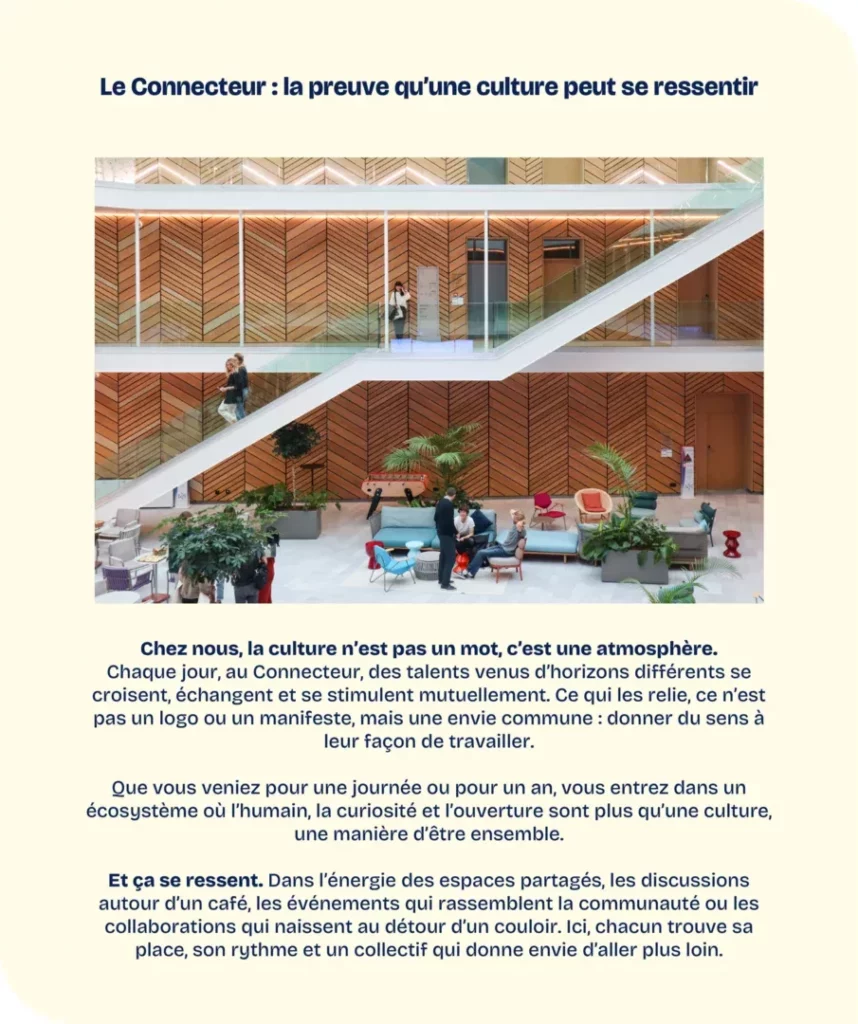
Croire ensemble, sans s’aveugler
Dans un monde du travail traversé par des mutations inédites, la culture d’entreprise reste un barycentre organisationnel : elle relie, elle oriente, elle rappelle qu’un collectif n’existe pas seulement pour produire, mais pour durer. Encore faut-il ne pas en faire une croyance aveugle. Comme l’écrivait Hannah Arendt, « le monde devient inhumain lorsqu’il est emporté dans un mouvement où ne subsiste aucune espèce de permanence ».
La culture n’a donc de valeur que si elle demeure vivante : incarnée, révisable et sans cesse éprouvée au réel.




